L’univers flou de Gerhard Richter
- Mestan Tekin
- 25 déc. 2025
- 5 min de lecture
À l’occasion de la rétrospective sur lui à la Fondation Vuitton je me dis que regarder une œuvre de Gerhard Richter ce n’est jamais une expérience confortable. On croit d’abord reconnaître. Une photographie. Un portrait. Un paysage. Puis quelque chose résiste. L’image ne se livre pas entièrement. Elle ne confirme rien. Elle se tient là, légèrement instable, comme si elle refusait de se fixer. C’est à cet endroit précis que commence le travail de Richter. Pas dans le style puisqu’il en a tellement. Pas dans le sujet puisqu’il les aborde tous. Mais dans une méfiance profonde envers l’image trop sûre d’elle.
Richter est un peintre techniquement solide. Il le sait. Nous le savons. Et pourtant, toute son œuvre semble organisée autour de cette idée paradoxale : la maîtrise n’est jamais suffisante. Pire encore, elle peut devenir un piège. Une image trop précise, trop juste,
trop bien tenue, finit par se fermer. Elle arrête le regard. Elle devient une image morte.

Images, autorité et méfiance
Richter grandit dans l’Allemagne nazie, dans un monde saturé d’images qui ne doutent pas. L’image y est directive. Elle affirme. Elle ordonne. Elle ne laisse aucune place au flottement. Cette expérience n’est pas théorique. Elle est vécue. Elle marque durablement son rapport à toute forme de représentation.
À cela s’ajoute un drame intime : la disparition de sa tante Marianne, victime du programme d’euthanasie nazi. Richter ne peindra jamais cet événement. Il ne le racontera pas. Il ne l’illustrera pas. Ce refus est fondamental. Il ne s’agit pas d’un silence par évitement, mais d’une impossibilité morale de produire des images qui affirment.

Quand Richter commence à peindre sérieusement, après sa formation à Dresde puis son passage à l’Ouest en 1961, cette méfiance est déjà inscrite dans sa pratique. Les premières peintures d’après photographies (Onkel Rudi ci-dessus, Tante Marianne…), les portraits familiaux sont retenues, presque froides. La matière est mince. Le pinceau s’efface. La surface est lisse. Rien n’est démonstratif.
Puis apparaît le flou!
Le flou comme exigence
Chez Richter, le flou n’est ni décoratif ni stylistique. Il est précis, localisé, contrôlé. Techniquement, il est obtenu par frottement léger, pinceau sec, chiffon, parfois la main, sur une peinture encore fraîche mais déjà stabilisée. L’image n’est pas détruite. Elle est rendue instable.

C’est essentiel. Trop peu de flou, l’image devient illustrative. Trop, elle disparaît. Richter cherche ce point d’équilibre fragile où l’image reste active. Où elle ne s’impose pas. Il l’a dit clairement : une image trop nette prétend à une vérité qu’elle ne peut pas tenir.
Le flou, au contraire, retire à l’image son autorité. Il la rend plus juste parce qu’il en montre la fragilité.

La série des peintures floutées d’après photographies, puis plus tard September (2005) ci-dessus, montre à quel point cette distance est difficile à maintenir. Dans ce tableau consacré aux tours jumelles, le flou est plus violent, plus cinétique. La peinture semble lutter contre l’événement. Comme si Richter avait du mal, cette fois, à tenir sa distance habituelle.
Le gris : neutraliser sans renoncer
Dans les années 1970, Richter peint une série de tableaux gris. Ils ont souvent été qualifiés de conceptuels. Pour un peintre, ils sont surtout radicaux. Ils posent une question simple et brutale : que reste-t-il quand on enlève à la peinture ce qui la rend expressive ?

Ces gris ne sont jamais neutres. Ils sont construits, instables, parfois verdâtres, parfois bleutés. Techniquement, ils proviennent rarement d’un simple mélange noir/blanc. Ce sont des gris salis, vivants, mais volontairement contenus.
Le geste est anti-expressif. Pas de centre. Pas de hiérarchie. Pas de narration. La surface est nivelée, presque administrative. Le gris devient une protection. Une peinture qui refuse d’exalter, de séduire, de convaincre.
Ce n’est pas un renoncement. C’est un refus de mentir.
Détruire pour ne pas se répéter
À partir des années 1980, Richter engage ses grandes abstractions raclées. Il sait peindre. Il sait composer. Il pourrait produire une abstraction efficace. C’est précisément ce qu’il refuse.

Le processus est lourd, physique. Il applique des couches épaisses de couleur, puis intervient avec de grandes racles en plexiglas. Ce geste n’est pas un effet visuel. Il détruit réellement ce qui vient d’être fait. Les couches inférieures réapparaissent par accident. Les couleurs se contaminent. La peinture résiste.
La composition n’est jamais pensée à l’avance. Elle émerge. Et surtout, elle est interrompue. Richter s’arrête quand le tableau devient trop lisible. Trop séduisant. Trop sûr de lui.
L’arrêt est le véritable geste. Continuer serait une trahison.
Copier Titien pour mieux échouer
Un épisode éclaire cette position de manière exemplaire. Richter réalise une copie d’un tableau de Titien. Techniquement, la peinture tient. Elle est juste. Mais cela ne lui suffit pas.
Il transforme alors cette image en une série de six peintures, qu’il dégrade progressivement, qu’il surfloute, qu’il altère jusqu’à l’illisible. Et c’est là qu’il trouve la peinture plus vraie.
Ce geste est capital. Il montre que la fidélité technique n’est pas une garantie de justesse. La précision ferme l’image. Elle arrête le pouvoir de la représentation. Le flou, au contraire, maintient l’image ouverte, active, profitable.
Séries, regard et distance
Richter ne s’attache jamais à un seul registre. Son œuvre traverse portraits, paysages, natures mortes, abstractions, nuanciers (ci-dessous). Les séries jouent un rôle central : elles empêchent l’image unique de devenir définitive.

Atlas est à ce titre fondamental. Des milliers d’images : photos banales, ratées, répétitives, essais de couleurs. Rien n’est hiérarchisé. Richter ne cherche pas des sujets. Il cherche des zones de frottement visuel. Des images qui ne demandent rien.

Les œuvres intimes suivent la même logique de distance. Ema, Betty (ci-dessus), les portraits d’Isa Genzken : dessin précis, valeurs contenues, palette froide. Tout est tenu. Le pinceau disparaît. Ce pourrait être sensuel. Ça ne l’est pas. Richter refuse la confession picturale.
Où il est, aujourd’hui
Richter vit et travaille à Cologne, dans une forme de retrait calme. Loin des discours. Loin du bruit. Il continue à dessiner, à expérimenter, à produire sans chercher à conclure sur petits formats.

Ce que Richter nous enseigne
Pour un artiste qui vise l’excellence, Richter n’est pas un modèle à imiter. Il est plutôt une exigence à affronter. Il nous rappelle que :
– la maîtrise est nécessaire, mais dangereuse
– la précision peut fermer l’image
– la virtuosité doit être tenue en suspicion
– l’arrêt est un geste à part entière
Peindre, chez Richter, n’est pas montrer ce que l’on sait faire mais plutôt résister à ce que l’on sait trop bien faire. On dit souvent aujourd’hui que pour qu’une peinture soit plus que « bonne », un élément doit être hors de contrôle. Cela peut être la couleur, la composition, la texture, le dessin… Richter a fait sauter la focale. Pour un artiste c’est absolument stimulant de lâcher du leste!
Après ces quelques observations et inspirations, n’hésitez pas à me consulter en atelier si vous aviez des questions sur les différentes techniques utilisées par Richter. Comment aborder le flou à l’huile ou l’acrylique? Comment planifier le raclage en abstraction ou en semi-figuratif. Comment aborder la peinture de sujets d’actualité?…
À vos pinceaux!
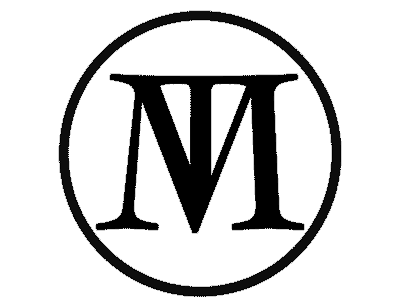


Commentaires