Pourquoi faisons-nous de l’art ?
- Mestan Tekin
- 31 déc. 2024
- 4 min de lecture
La question « Pourquoi faisons-nous de l’art ? » soulève des enjeux complexes qui transcendent les limites de la simple expression individuelle. Chaque jour en atelier, vous êtes nombreux à apporter votre énergie et votre personnalité au service d’un même geste créateur, mais pour des raisons souvent différentes. Faire de l’art, c’est répondre à des besoins fondamentaux profondément ancrés dans notre cerveau, notre culture et notre humanité.
En explorant les mécanismes cérébraux, les besoins primaires et les dimensions sociales et spirituelles de la création artistique, nous découvrons que cet acte est aussi vital qu’il est mystérieux. L’art n’est pas seulement une activité humaine : c’est une pulsion vitale qui nous définit. L’atelier étant un lieu témoin de toutes ces activités primordiales, il me semble donc très pertinent de vous faire part de quelques éléments de réponse très intéressants.

L’art comme un besoin primaire : Structurer le chaos
Depuis les origines, l’être humain crée pour donner du sens au monde qui l’entoure. Les peintures rupestres de Lascaux ne sont pas de simples images décoratives : elles témoignent d’une volonté de comprendre, de narrer et de maîtriser un univers souvent hostile. Ces œuvres sont les premières manifestations d’un besoin primordial : structurer le chaos.

Au niveau cérébral, ce processus fait appel au cortex préfrontal, qui orchestre notre capacité à planifier et à donner du sens, et au système limbique, siège de nos émotions. Lorsque nous créons, ces deux parties du cerveau collaborent, nous permettant de transformer des sensations ou des idées en formes tangibles. Ce besoin de structuration est si fondamental qu’on le retrouve dans tous les domaines de la vie humaine : science, religion, philosophie et, bien sûr, art.
Prenons l’exemple d’un artiste face à une toile blanche. Ce vide initial représente une forme de chaos potentiel. Chaque coup de pinceau est une tentative de domestiquer cet espace vierge, d’y inscrire une vision, une narration ou une émotion. Ce processus, bien que mental et technique, répond à un instinct primaire profondément ancré. En abstraction, la feuille de route est moins prédéfinie par rapport à l’art figuratif. Le dialogue entre le cortex préfrontal et le limbique se structure différemment pour aboutir à un résultat quasi similaire : on finit toujours par structurer l’espace de la toile à partir du néant.
L’art comme moyen de communication : L’universel au-delà du langage
L’art est un langage sans mots. Là où le langage parlé ou écrit peut être limité par des barrières culturelles ou linguistiques, l’art transcende ces frontières pour communiquer sur un plan universel. Cette capacité unique de l’art à exprimer l’indicible répond à un autre besoin fondamental de l’être humain : être compris et comprendre les autres.
Les neurosciences montrent que l’art stimule les mêmes zones du cerveau que celles utilisées pour interpréter les expressions faciales ou les émotions des autres. Cela explique pourquoi un tableau de Delacroix peut nous bouleverser ou pourquoi une sculpture de Michel-Ange peut nous émerveiller : l’art agit directement sur notre système de résonance émotionnelle.

Un exemple éloquent est la peinture de Guernica par Picasso. Ce chef-d’œuvre n’a pas seulement été créé pour dénoncer les horreurs de la guerre civile espagnole, mais pour établir un dialogue universel avec quiconque contemple la douleur et la destruction. En un seul regard, cette œuvre communique plus qu’un traité ou un discours.
Les mécanismes cérébraux du plaisir créatif : La récompense de l’effort
Créer de l’art est une activité profondément gratifiante, car elle mobilise le système de récompense du cerveau, déclenchant la libération de dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la satisfaction. Ce mécanisme explique pourquoi, même face à des obstacles techniques ou conceptuels, l’acte de création est perçu comme intrinsèquement gratifiant.
Plus encore, la création artistique active un état de flux, une expérience optimale où l’artiste est entièrement absorbé par son activité. Dans cet état, le temps semble s’arrêter, et l’individu fusionne avec son œuvre. Ce phénomène n’est pas uniquement agréable : il est profondément bénéfique pour la santé mentale, réduisant le stress et améliorant la résilience.

Une partie de ces événements cérébraux se déroule dans le lobe droit, d’où l’association fréquente entre créativité et cerveau droit.
Ce mécanisme est d’ailleurs une pierre angulaire de l’art-thérapie, qui repose sur la gratification par étapes pour dérouler un processus thérapeutique. Cet aspect mériterait à lui seul un article détaillé.
L’art comme quête de sens : Sublimer le vide existentiel
L’une des raisons pour lesquelles nous faisons de l’art est la quête de sens. Cette quête s’enracine dans notre conscience de la finitude : l’art devient un moyen de dépasser la mortalité, d’inscrire une trace dans un monde où tout est éphémère.
Les œuvres d’artistes comme Eugène Delacroix ou J.M.W. Turner sont autant de tentatives de sublimer cette quête. Les paysages tourmentés de Turner, par exemple, traduisent une tension existentielle entre la puissance écrasante de la nature et la petitesse de l’être humain. Ce n’est pas seulement un acte de représentation, mais un dialogue entre l’artiste et le cosmos.

Je ne peux m’empêcher de penser aux autoportraits de Van Gogh, qui illustrent parfaitement la résilience émotionnelle.
Faire de l’art : Une pulsion vitale et universelle
Si l’art est universel, c’est parce qu’il répond à des besoins fondamentaux et transcende les spécificités culturelles ou historiques. Nous faisons de l’art pour structurer le chaos, communiquer, ressentir du plaisir, trouver un sens et explorer l’invisible.
L’art est une affirmation de notre humanité, une preuve tangible que nous sommes là, que nous ressentons, que nous pensons. Il est à la fois personnel et collectif, individuel et universel, éphémère et éternel.
L’art a évolué au gré de l’évolution de notre cerveau, du reptilien à un néocortex préfrontal plus développé. Il est à notre image, quels que soient les moments de l’Histoire. C’est pour cela que nous ne ressentirons jamais l’art de la même façon que lorsqu’il a été créé.
En atelier, je dis souvent que l’art se résume au désir de créer une œuvre et au plaisir de la réaliser. C’est cette pulsion qui nous rend profondément humains.
À vos pinceaux !
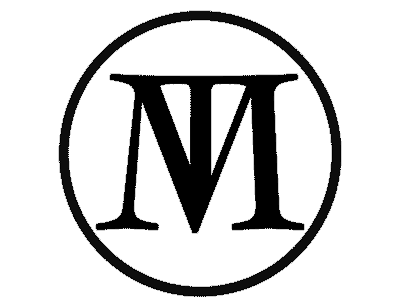

Commentaires